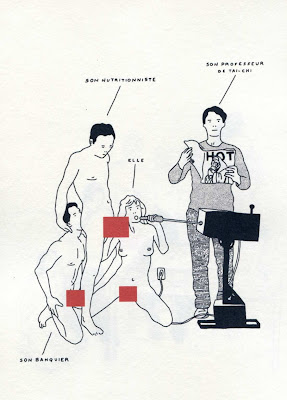était loin de proposer autant d’articles que de collaborateurs annoncés en première page. J’attendais en effet un article de René Blum (ici annoncé comme “collaborateur” car auteur de la préface du catalogue de l’exposition du même nom) et ce fut sans. En revanche, faisant rétrospectivement écho à son article intitulé « Musique d’aujourd’hui » paru dans Les Soirées de Paris en mars 1914,
Francis Picabia et Gabrielle Buffet circa 1910
l’article de Gabrièle Buffet intitulé « Impressionnisme musical » fut une bonne surprise. Il faudrait, idéalement, le commenter et déterminer sa place dans l’histoire de la critique musicale… Comme pour les autres documents mis en ligne sur le blog de L’Œil cacodylate, je livre ici ces deux articles à l’état d’archive, ainsi que la préface de René Blum au catalogue de la Section d’Or.
Une fois encore, c’est à la bibliothèque Kandinsky que j’ai pu consulter une des rares plaquettes publiées par Pierre André Benoît. Publié sans titre, « imprimé 36 fois à Alès par PAB le 1er octobre 1969 », cet hommage à Marcel Duchamp, paru un an après la disparition de ce dernier, comporte quatre textes (Man Ray, Gabrielle Buffet, Pierre de Massot et Robert Lebel), un collage de l’éditeur et une gravure en fin de volume non mentionnée mais sans doute réalisée par Alexandre Calder – auquel on doit également la gravure ornant la couverture de cet opuscule et composée uniquement des lettres du prénom de l’inventeur du ready-made. La légende de la gravure est la suivante :
M. Duchamp
Born like a light
Lived like a light
Out like a light
And that was the delightful life
of Marcel Duchamp
@ @ @
Impressionnisme musical
La musique traverse actuellement une période assez semblable à ce qu'a été au dernier siècle l'impressionnisme pour la peinture.
C'est au nom des lois naturelles de la vibration sonore qu'elle s'échappe de la scholastique et de la rhétorique musicale, et réagit contre l'arbitraire ides codes d'harmonie et des lois de composition.
Ainsi en peinture les lois de la vibration lumineuse ont été Je point de départ des théories impressionnistes ; et dans les deux cas ces théories aboutissent plus à une recherche, de réalité objective qu'à un effort de création.
Les impressionnistes et néo-impressionnistes ont tenté de donner sur une toile l'illusion de l'atmosphère, de la lumière vibrante, par l'emploi des complémentaires et la division des tons.
Très semblable à ce système est l'adjonction à l'accord parfait des harmoniques éloignées de la fondamentale, accord qu'on trouve abondamment dans toutes les œuvres modernes et qui donne l'illusion des sons en mouvement dans l'atmosphère. La tonalité s'affirme non plus, par les rapports simples de tierce et de quinte, mais par un subtil amalgame de toutes les subdivisions du son fondamental, dont notre oreille suit à peine la logique tonale.
L'idée musicale n'est plus un discours abstrait, mesuré, coupé de périodes bien définies ; une ligne dont on suit le dessin précis, mais une suite d'embryons de lignes dépendantes du travail harmonique, et que l'on discerne peu dans l'ensemble des subtiles combinaisons et des dissonances. L'impression esthétique que nous en avons, est moins le résultat de la logique suivie de l'idée, que le plaisir tout sensoriel de cet enchevêtrement de vibrations sonores : moins une « ordonnance » que la recherche d'harmonies rares, dont la valeur d'expression ne dépend point d'une idée mélodique directrice, mais de leurs rapports réciproques, de leur relativité.
En résumé, nous constatons un enrichissement prodigieux de la « matière » musicale, l'épanouissement de toutes les ressources naturelles de la musique, mais... la musique elle-même a-t-elle profité de ces nouvelles richesses ?
Nous nous en rapportons aux œuvres pour nous faire une opinion sur ce sujet, et sommes amenés à constater la faiblesse générale, à quelques exceptions près, des productions résultant de ces tendances; leur inconsistance, leur manque de profondeur, qui, d'ailleurs, nous apparaît nettement aussi dans les recherches impressionnistes de la peinture.
La preuve en est aussi dans l'impossibilité de la musique actuelle à vivre d'elle-même, sans un canevas littéraire quelconque. Au contraire de la peinture actuelle qui tend vers une liberté d'expression de plus en plus grande, la musique, malgré la richesse nouvelle de son « matériel », ne se suffit plus à elle-même, et les œuvres pour exister doivent s'étayer sur un programme dont elles prétendent faire la description exacte.
La musique devient ainsi une sorte d'imagerie sonore. Comment ne point comprendre la puérilité de cette recherche, et que plaquer des harmonies si nouvelles, si subtiles soient-elles, sur une carcasse littéraire, sans architecture propre, n'est point faire de la musique ?...
Comment ne point conclure (forts aussi de l'exemple que nous a donné l'impressionnisme en peinture), à l'impossibilité d'un grand essor de la musique actuelle.
Et alors que nous importe d'être sortis des codes harmoniques, des formules, des moules anciens, si ce n'est que pour arriver à un asservissement plus grand de la musique elle-même, à d'autres procédés, qui risquent d'entraver, plus encore son développement ?
Gabrielle Buffet in Numéro Spécial consacré à l’Exposition de la “Section d’Or”, 9 octobre 1912. N° 1 et seul paru.
@ @ @
Musique d’aujourd’hui
Les tendances actuelles de la musique nous paraissent très indécises et contradictoires.
L'école de Franck, rigoureusement scholastique, a par sa vigueur même provoqué une poussée violente dans un art plus libre et plus sensoriel, basé sur la recherche des sonorités, des harmonies, des rythmes pour eux-mêmes et non plus sur la logique d'un code musical conventionnel.
Ce fut l'envahissement de tous les domaines défendus : suppression des frontières arbitraires de la consonance et de la dissonance, des lois de tonalité et d'architecture ; transformation de la phrase mélodique à périodes régulières assujetties à un syllogisme tonal en phrase harmonique libre, sans autre limite que la forme de ses rythmes.
L'épanouissement de toutes les ressources de l'orchestre, l'orgie de combinaisons inconnues de sons et de sonorités ; enfin, un considérable enrichissement de toute la « matière » musicale.
Il est curieux de constater, et c'est là la contradiction dont nous avons parlé, que malgré cette vigoureuse réaction, l'œuvre musicale de notre époque, reste sans grande puissance ni originalité.
Ou c'est l'adaptation de musiques anciennes et surtout étrangères A de nouvelles habitudes sonores; ou c'est une recherche de sonorités précieuses et imprévues, mais vides de pensée, dont l'oreille et l'esprit se lassent sitôt l'accoutumance venue.
Le fait d'avoir rejeté les vieilles formes n'a pas suffi à déclencher une évolution précise. Elle est restée superficielle : une évolution de métier. L'esprit musical a été troublé sans être renouvelé. L'inspiration moderne n'a point la force de se défricher line nouvelle route, elle reste timide et indécise et est, malgré tout, un compromis entre les anciennes traditions et les libertés nouvelles.
Sans doute, est-il des époques où tel art correspond mieux qu'un autre aux besoins existants.
Il ne nous semble pas, malgré ln vulgarisation générale de la musique, l'engouement et certes la plus réelle compréhension qu'on eût de cet art, que nous soyons dans une période qu'on ait de cet art, que nous soyons d'ans une période musicale.
Les œuvres ultra-modernes nous en sont une preuve. Plus d'essais de musique pure, mais des formes mi-dramatiques, mi-musicales, c'est-à-dire que l'architecture idéale des formes anciennes, sonates, symphonies, etc., etc., est remplacée par un motif littéraire auquel la musique s'assujettit rigoureusement et qui est la carcasse même de l'œuvre : développement à outrance du poème symphonique, de la musique à programme, avec programme de plus en plus précis, musique de scène, musique de danses, tableaux symphoniques et enfin, le « tout dernier genre », celui des pièces descriptives où l'on peut constater l'absorption de l'élément musical par l'élément littéraire.
Nous donnerons, pour plus de clarté, un exemple du genre en question.
Il s'agit d'une petite pièce pour piano intitulée, je crois : La Bavarde, parfaitement comique, mais qui dans sa cocasserie caractérise bien des tendances actuelles.
Un thème s'expose : c'est l'air connu de tous, « Ne parle pas, Rose, je t'en supplie », qui incarne le mari affolé par le bavardage de sa femme. Suivent une série de rythmes courts dont l'explication nous est fournie par le texte littéraire écrit il même la partition au-dessus du texte musical : ce sont les sornettes que débile la bavarde : « La concierge s'est cassée une côte ... », « Je voudrais un chapeau en acajou massif... », etc., etc. Nouvelles supplications du mari sur le thème de Rose, nouveaux bavardages. Enfin, le thème de Rose revient encore, mais défiguré et assombri, et le texte nous apprend que le pauvre homme est mort excédé.
L'on se rendra compte, par cette analyse, du rôle très restreint de l'élément musical. L'auteur n'a pas même pris le mal de chercher un thème personnel, la popularité de l'air de Rose suffisant à symboliser pour tous, le personnage de son petit drame. La qualité musicale n'y a plus aucun intérêt, et c'est juste ce qui nous intéresse dans cette œuvre (malgré que nous la considérions plus comme une plaisanterie, que comme une tentative sérieuse).
Il s'agit seulement qu'une compréhension s'établisse entre l'œuvre et le public par l'intermédiaire d'un symbole musical quelconque.
C'est l'innovation d'une musique représentative, d'une musique à motifs et à légende. Nous nous étonnons que l'on n'ait pas encore cherché à élargir à des œuvres plus importantes, à des œuvres d'orchestre, le genre en question. La raison en est, sans doute, la difficulté pour un public de concert symphonique, chacun ne pouvant avoir une partition, de suivre la partie littéraire explicative de la musique. Il suffirait, pour remédier à cet inconvénient qui rend impossible la réalisation au concert d'œuvres de cette sorte, d'installer dans la salle un écran de cinématographe sur lequel apparaîtrait simultanément avec la musique le texte littéraire, et qui pourrait ainsi être suivi de toutes les places. Peut-être, serait-ce le point de départ d'une forme d'art tout à fait neuve, qui n’aurait plus grand point de ressemblance avec ce que nous avons appelé jusqu'à ce jour, musique et composition musicale. Mais serait une sorte de symbolisme sonore. Même poussant à l'extrême toutes les possibilités, on peut émettre l'hypothèse d'un art musical de plus en plus représentatif.
Grâce à des bruiteurs mécaniques et perfectionnés, une reconstitution objective de la vie sonore deviendrait possible. Nous découvririons la forme des sons en dehors de la convention musicale, et ceci est, après tout, aussi vraisemblable, que de voir la peinture abandonner la représentation objective, pour s'échapper dans le domaine de la spéculation pure.
Gabrielle Buffet, Les Soirées de Paris, n° 22, mars 1914, pp. 181-183.
@ @ @
PREFACE
Les quelques artistes dont on trouvera les travaux groupés ici, exposèrent l'an dernier dans une galerie où l'espace restreint nuisait à leurs œuvres. Aujourd'hui, présentées dans un cadre plus favorable, suffisamment isolées, elles prennent séparément, ou dans leur ensemble, toute leur signification.
Quelle que soit l'impression que vous laissera cette visite, il vous sera difficile de ne pas louer l'effort tenace de jeunes artistes, poursuivant la voie qu'ils se sont tracée sans souci des obstacles, sans se préoccuper des objections ou des ricanements d'un certain public. Ils n'ont pas de tendances communes, ni, d'entre eux, d'affinités profondes, mais une unique pensée les dirige : dégager l'art de sa tradition, de ses liens surannés, le libérer, en un mot car c'est le libérer que l'asservir étroitement à la personnalité de l'artiste.
Arrêtez-vous devant ces toiles aux couleurs vives, regardez ces bustes aux formes hardies, et tâchez à découvrir une influence. Echappant à toute contrainte, refusant toute direction, les exposants ne doivent rien qu'à eux-mêmes. C'est de leur sensibilité qu'ils reçoivent l'enseignement et l'inspiration.
Ce ne sont point des divergences d'école que vous trouverez ici. Vous ne constaterez que des écarts de sensibilité. Et il faut admettre avec nos artistes qu'à la sensibilité vient se joindre un élément nouveau : l'imagination qui permet toutes les variétés, autorise toutes les forces d'art, favorise les combinaisons les plus audacieuses, leurs heurts les plus inattendus, crée une harmonie presque toujours faite de contrastes.
Cette collaboration permet de dépasser les limites de l'impressionnisme. La formule de Monet n'est plus suffisante. Le peintre ne se soucie plus d'un moment ou d'une couleur; son cerveau peut lui offrir d'innombrables visions de nuances et de formes. La nature n'est plus que l'élément suggestif de son art.
Parmi ces novateurs, quelques-uns furent séduits par une même technique, ce n'est point ici l'endroit de la discuter. Cette discipline n'est pas d'ailleurs l'élément qui nous requiert le plus; ce n'est pas en elle qu'il faut voir le principal attrait d'un art qui vaut surtout par l'affirmation de la personnalité.
Cette conception est encore neuve et les tentatives de nos artistes, bien qu'elles marquent un progrès constant, trouvent encore le public réfractaire et parfois hostile. S'ils n'ont pas le bonheur de convaincre ou ne recueillent pas directement le fruit de leur initiative, du moins, auront-ils le mérite d'avoir montré la route et c'est à eux que pourra revenir l'honneur d'une rénovation.
RENÉ BLUM. Préface au catalogue du Salon de la Section d'or à Paris (10-30 octobre 1912), Galerie la Boétie.